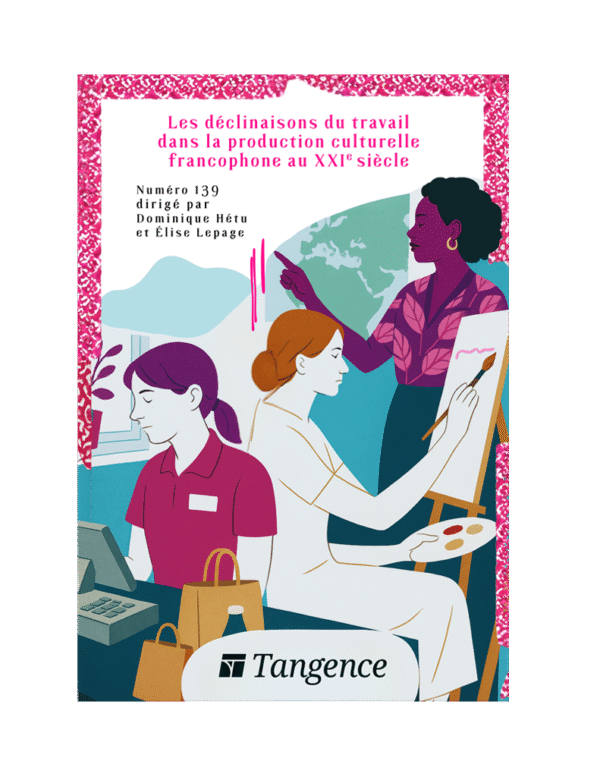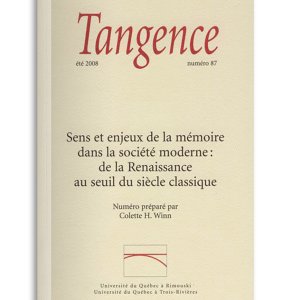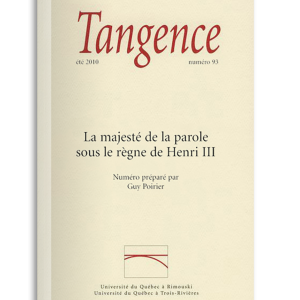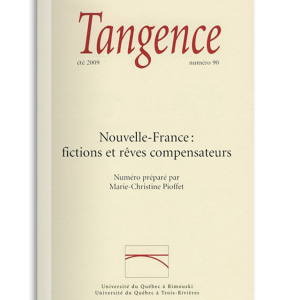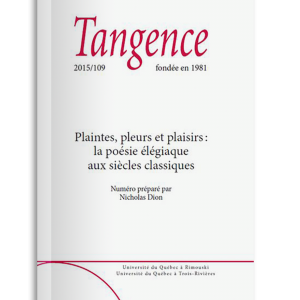Dérives néolibérales dans Wollstonecraft, de Sarah Berthiaume
Marie-Claude Garneau
Cet article interroge les enjeux de la production, de la reproduction et de la création qui se dessinent dans la pièce Wollstonecraft de la dramaturge québécoise Sarah Berthiaume et les rapports qui s’esquissent entre eux en ce qui les lie à la notion de travail. Dans une analyse dramaturgique qui s’appuie, entre autres, sur les théories critiques du néolibéralisme, sur la sociologie du travail créateur et sur une méthodologie de la lecture féministe du texte dramatique, cette étude propose les réflexions suivantes : quelles dynamiques entre les personnages se développent suivant le rapport que chacun·e entretient face à son travail et quel discours tient-il·elle au sujet de celui des autres ? Comment chacun·e vit-il·elle la création artistique ou la phase créative de son travail et comment celle-ci influence-t-elle les rapports avec les autres personnages ? Au terme de la trajectoire analytique, l’objectif de l’article sera d’éclairer la manière dont la dramaturgie de Berthiaume brosse un portrait critique du monde du travail artistique contemporain.
« Personne ici ne doit se sentir responsable de quoi que ce soit » : naturalisme, marchandage et capitalisme de surveillance dans La loi du marché de Stéphane Brizé (2015)
Florian Grandena et Pierre-Luc Landry
La loi du marché de Stéphane Brizé (2015) met en scène Thierry (interprété par Vincent Lindon), chômeur cinquantenaire contraint d’accepter un emploi de gardien de sécurité dans un supermarché pour subvenir aux besoins de sa famille. Ce film expose frontalement l’assujettissement des individus au sein de la société néolibérale et leur déshumanisation au travail et par le travail : premièrement, par l’esthétique naturaliste du film montrant sans fard la réalité brutale du système ; deuxièmement, par l’intermédiaire d’une culture quasi quotidienne de la négociation et du marchandage ; et troisièmement, par l’utilisation des techniques de surveillance proches de celles du panoptique. Cet article suggère de réfléchir aux qualités et aux limites de La loi du marché en tant que « film social » ; cette analyse en contrepoint s’appuie principalement sur le texte désormais classique de Jacques Rancière, « Il est arrivé quelque chose au réel » (2000), incontournable dans la saisie des différentes modalités de l’inscription de figures de la dissidence dans le cinéma contemporain.
Espace domestique et travail dans Chez soi de Mona Chollet
Adina Balint
La représentation du travail en rapport avec l’espace domestique occupe une place primordiale dans l’essai Chez soi. Une odyssée de l’espace domestique (2015) de Mona Chollet, un texte hybride superposant des discours philosophiques et sociologiques et des témoignages personnels. À partir des paradigmes du travail d’Anthony Hussenot, chercheur français en sciences de la gestion, et de la notion d’« écriture du travail » de Dominique Viart, cet article propose une mise en évidence de certaines conceptions du travail en Occident aujourd’hui, une analyse thématique et une étude des stratégies discursives de Chez soi. L’hypothèse développée est que, dans l’essai, la figuration de pratiques de travail alternatives au domicile (lire, écrire, faire des recherches sur Internet) s’inscrit dans une démarche de création de nouveaux modes de vie et d’écriture qui remettent en question le productivisme et l’injonction à l’accélération propres aux sociétés néolibérales occidentales contemporaines.
Fly-in, Fly-out : le travail en région éloignée dans Les murailles d’Érika Soucy
Élise Lepage
Cet article propose une réflexion sur la représentation du travail en région éloignée, plus spécifiquement sur un chantier hydroélectrique dans la région de la Côte-Nord au Québec. La réflexion se déploie principalement à partir du récit Les murailles (2016) d’Érika Soucy, dans lequel la narratrice raconte son séjour dans un camp du chantier de La Romaine pour retrouver son père, le temps de quelques jours. Ce faisant, elle découvre un univers de travail qui occupe une grande part de son récit. La réflexion procède à travers trois approches successives : en premier lieu, les travaux de la géographe Caroline Desbiens fournissent une contextualisation d’ordre historique et géographique pour comprendre l’importance de ces chantiers hydroélectriques dans l’histoire et l’imaginaire québécois. Recentrant ensuite la réflexion sur le récit de Soucy, est mobilisé le concept de « personnel romanesque » théorisé par Philippe Hamon, puis par Isabelle Kirouac Massicotte dans le contexte québécois et canadien, afin de montrer à quel point ce type de récit centré sur un lieu de travail tend souvent à réduire de nombreux personnages à une double fonctionnalité : leur fonction au sein de ce site de travail et leur fonction narrative au sein du récit. Enfin, les théories du care permettent une analyse critique des divisions du travail rémunéré sur le lieu de chantier, mais aussi du travail de care au sein des familles des travailleurs. Cet article approche donc le récit Les murailles d’Érika Soucy comme un témoignage du travail sur un chantier hydroélectrique, et une réflexion sur les façons dont ce type de mégaprojet conditionne la vie des travailleurs et de leurs proches.
« incapable de travailler à autre chose » : filiation, accompagnement et création chez Véronique Cyr et Sophie Dora Swan
Dominique Hétu
Les récits La jeune fille des négatifs, de Véronique Cyr (2022) et Voir Montauk, de Sophie Dora Swan (2023) racontent, à travers une hybridité générique qui permet de mettre en oeuvre différentes formes d’un « espace du dire », les expériences vécues de la maladie, de la maternité, de la filiation, de l’accompagnement et du travail de l’écriture des deux autrices. Cet article propose une étude comparée de ces récits hybrides et de leur configuration à la fois semblable et opposée des liens entre mère et fille, entre l’âge de l’enfance et l’âge adulte, par des processus de création composites, ancrés dans l’intimité d’une main tendue vers l’autre, marqués par une intertextualité féministe qui se rejoint et informe une écriture contemporaine particulièrement attentive aux ambivalences et aux vulnérabilités du care. Ces notions de l’attention et de la vulnérabilité, mobilisées entre autres chez Sophie Bourgault, Veena Das et Sandra Laugier – penseuses du care, du vulnérable et de la voix – éclaireront aussi les possibles de l’écriture « malgré les ravages du lien » comme l’écrit Véronique Cyr.