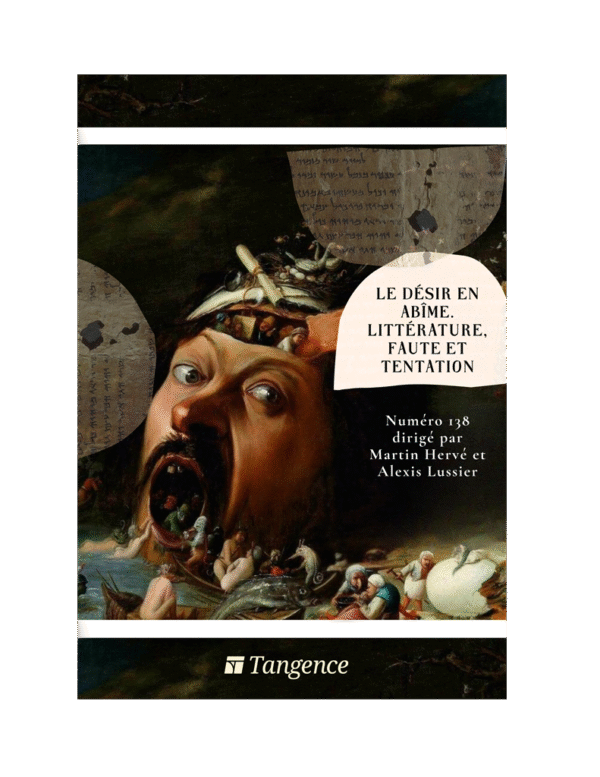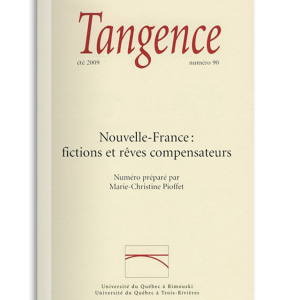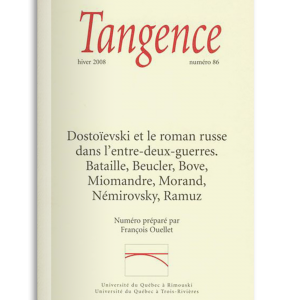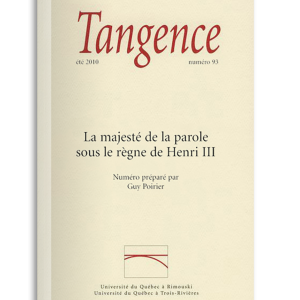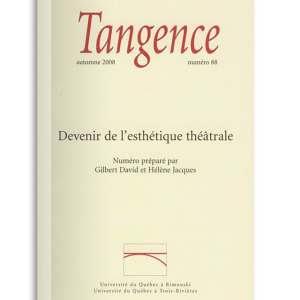L’épreuve du désir. Figures de la tentation dans les traductions de la Bible au Moyen Âge
Francis Gingras
Dès le XIIe siècle, on voit apparaître des traductions des textes liturgiques et des paraphrases de la Bible qui deviendront rapidement des traductions complètes dont nous connaissons aujourd’hui plusieurs versions, souvent préservées dans plus d’un manuscrit. L’exploration des choix de traduction et des interprétations qui en découlent, à partir de cet ensemble de traductions françaises produites entre le XIIe et le XIVe siècle, permet de jeter un éclairage particulier sur la façon de penser la tentation dans notre univers linguistique, tout en lui donnant une certaine profondeur historique. Les plus anciennes traductions de la Bible en français reconduisent ainsi l’idée que la tentation est d’abord une mise à l’épreuve des fils par le père. Réversible dans l’Ancien Testament, elle devient plus spécialement l’œuvre de Satan, l’Adversaire, dans le Nouveau. Dans tous les cas, elle est associée à l’énonciation de la Loi. Dès lors, dans la mise à l’épreuve du désir, il est moins question de femmes tentatrices que du Tentateur singulier, en lien direct avec le nom du Père à qui le chrétien implore quotidiennement de ne pas le soumettre à la tentation.
D’une trompeuse absence : « tenter » et « tentation » dans l’œuvre de Pascal
Pierre Lyraud
Le lexique de la tentation brille, dans l’œuvre de Pascal, par sa quasi-absence. Devons-nous pour autant conclure à l’absence de la chose ? Si le mot tentation ne suffit sans doute pas à dire la vie du pécheur pour Pascal, sa discrétion impose en fait une assez grande spécification permettant de préciser les dimensions de la tentation qui importe le plus à l’œuvre pascalienne. C’est ce que l’article examine en insistant d’abord sur la force attractive d’une tentation infinie, puis sur l’épreuve qu’elle constitue et enfin sur l’ignorance du retrait de Dieu dont elle témoigne. Plus que la lutte contre les tentations, comptent ainsi pour Pascal le dynamisme antithétique du péché et de la grâce, la noirceur insondable du mal et, plus que tout, son opposition à la recherche sincère de Dieu qui définit, dans une partie des Pensées, un projet bien plus consolateur et lumineux que la tradition ne l’a dit.
« Se faire un délice de la tentation qui les tourmente ». Le désir de l’abîme, ou la tentation de la chute dans la fiction libertine
Marine Ganofsky
Cet article se penche sur la représentation de la tentation érotique dans les récits libertins du XVIIIe siècle. Nous y voyons que le motif de la tentation permet aux auteurs d’explorer la psyché de leurs personnages tout en remettant en question les sanctions que la société d’Ancien Régime imposait à la sexualité – notamment féminine. L’enjeu de cet article est de montrer que les tentations libertines cristallisent l’internalisation du Mal au siècle des Lumières : la tentation y est en effet configurée comme la révélation d’un désir profond et intime plutôt que comme une sollicitation externe du diable. Dans cette mise à l’épreuve de sa volonté, l’individu découvre qu’il n’est le jouet passif ni des démons ni de sa nature. Doué du libre arbitre, il se caractérise par sa liberté dans le choix entre le bien et le mal, l’agréable et le raisonnable. Voilà pourquoi la chute elle-même, malgré ses dangers, apparaît pour les personnages tentés comme une expérience de liberté ; et voilà pourquoi la tentation est, elle, présentée comme un frisson délicieux.
Pensée raisonnante et pensée fantasmatique de Rousseau à Freud
Alexis Lussier
Cet article repère dans un premier temps l’usage du mot « roman » dans les Confessions de Rousseau. De là, il s’agit de comparer le sens du « roman », du côté des mémoires de J. W. von Goethe (Poésie et vérité), d’une part, et d’autre part, du côté de l’œuvre de Freud, au moment précis où il s’occupe du cas de l’homme aux rats, encore aujourd’hui considéré comme un cas paradigmatique pour l’intelligence de la névrose obsessionnelle. Il ressort de ces différents recoupements que Freud fait un usage du mot « roman » tout à fait comparable à l’usage qu’en font Rousseau et Goethe ; et ce, alors que la conception d’un roman intérieur, le roman que l’on se fait à soi-même, brouille la distinction classique entre pensée raisonnante et pensée fantasmatique. Dès lors, de Rousseau à Freud, de Goethe à l’homme aux rats, pensée raisonnante et pensée fantasmatique se relaient dans un espace qu’il faut bien appeler l’espace d’une intériorité subjective où se jouent le drame de la conscience, la hantise de la faute et l’attrait de la tentation. Sur ce point, cet article propose d’examiner une intuition nouvelle, en considérant le texte que Freud a consacré à l’homme aux rats parmi les textes majeurs pour penser les rapports entre psychanalyse et littérature.
Malaise dans la lecture : l’homosexualité selon Marcel Jouhandeau, entre stratégie existentielle et expérience esthétique
Martin Hervé
À la charnière des XIXe et XXe siècles, l’avènement d’une littérature homosexuelle ne va pas sans provoquer scandales et anathèmes qui réactivent l’ancestrale condamnation portée contre les mauvais livres et les puissances nocives attribuées à la littérature. Certains, comme Marcel Jouhandeau, n’hésitent pas cependant à se couler dans le stéréotype de l’auteur « inverti » et tentateur, car agent d’inversion, mais pour le réinventer par des voies détournées qui sont des voies éminemment esthétiques. Homosexuel et catholique, moraliste autoproclamé du vice cherchant en enfer une sainteté paradoxale, Jouhandeau fait partie de ces écrivains qui mettent la littérature au travail afin de s’inventer eux-mêmes. C’est du lieu même de l’écriture qu’il bâtit une règle de vie qui lui est propre et qui le justifie. Entre 1920 et 1940, ses textes élèvent l’homosexualité au rang d’une stratégie de justification existentielle, où le « mal » n’est jamais abandonné et la tentation est valorisée pour elle-même. Mais surtout, Jouhandeau fonde à partir de cette stratégie une expérience éminemment littéraire de subversion, dont l’effet ne se soutient que d’une opération langagière falsifiée, pervertie, où c’est le propre désir de son lecteur qui se trouve emporté et amené à se perdre.
La tentation sur la scène pronominale. Réflexions à partir de La fiancée juive d’Hélène Cixous
Julie Gaillard
Sous-titré De la tentation, La fiancée juive d’Hélène Cixous évoque une passion amoureuse à la manière d’une réécriture du Cantique des cantiques. La tentation ne s’y donne pas à lire sous un prisme moral, mais caractérise bien plutôt l’état qui succède à l’ouverture de la temporalité dès lors que l’on sort de l’union des amant·es, éternelle, divine. Hors de cette jouissance atemporelle engageant l’expérience d’une désubjectivation, toute retombée dans le temps et dans l’espace ouvre la scène pronominale qui creuse la distance du « moi » au « toi ». À partir d’une analyse des perturbations infligées à la structure pronominale par le travail de la tentation, cet article s’attache à explorer leurs enjeux à la fois littéraires, psychanalytiques et féministes, montrant comment Hélène Cixous, dans une subversion féministe du thème de la Chute dénouant tentation et culpabilité, cherche par l’écriture à inventer un amour basé non plus sur la possession du sujet, mais sur l’ouverture à l’autre.