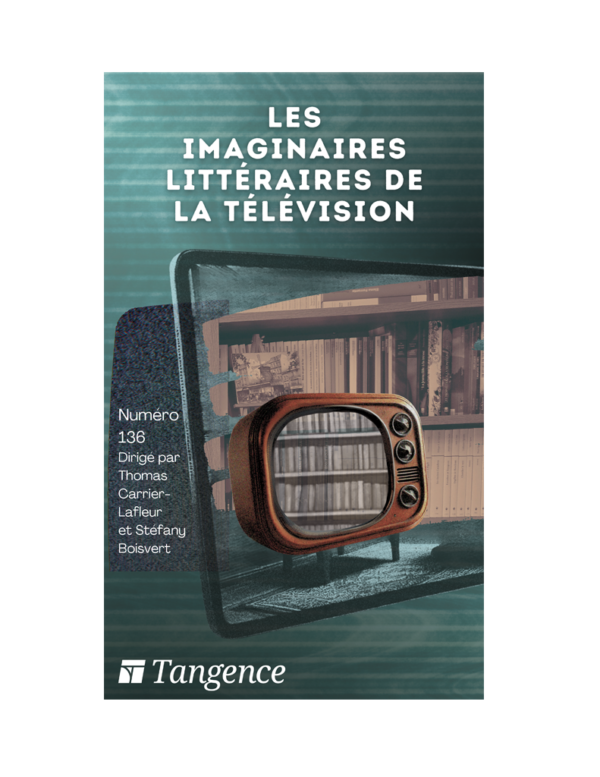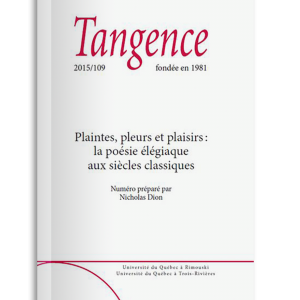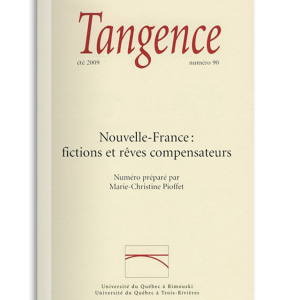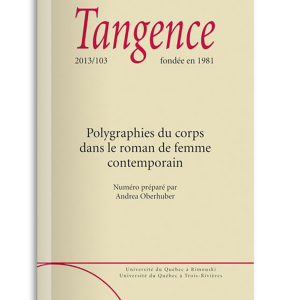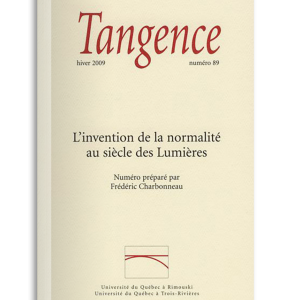Numérimorphose et mutations de la télévision et des écrans dans Mukbang de Fanie Demeule
Caroline Loranger
Mukbang de Fanie Demeule aborde l’influence des écrans dans la société moderne à travers le mukbang, pratique lors de laquelle des internautes regardent des vidéos de personnes mangeant de grandes quantités de nourriture en direct sur YouTube. Le roman rapporte le destin de Kim Delorme, une jeune influenceuse qui perd la vie en essayant de consommer 20 000 calories lors d’un de ces mukbangs. Dans cette œuvre, Demeule utilise plus de 200 codes QR pour enrichir le récit avec des contenus numériques, soulignant ainsi les thèmes de la cyberdépendance, des troubles alimentaires et de l’isolement social malgré une hyperconnexion. L’article analyse la représentation négative de la société de l’écran dans Mukbang, en utilisant le concept de « numérimorphose » pour décrire la transformation de la télévision en média numérique, exacerbant ses aspects les plus sombres sur Internet. L’autrice explore comment cette mutation est thématisée dans le roman et comment les codes QR intégrés dans le texte permettent aux lecteurs de ressentir directement les effets des écrans. Cette approche enrichit l’expérience de lecture, transformant le roman en un « livre-écran » qui réfléchit sur l’influence et les possibles dangers des nouveaux médias.
La télévision interne de l’être : vers une phénoménologie du petit écran
Cédric Kayser
Si l’expérience de la télévision a pu faire l’objet d’une lecture sociocritique en littérature et si certains auteurs de la postmodernité ont fait valoir l’atmosphère électrique des années 1980, qui coïncident de près avec les enjeux de la Guerre froide, rares sont les études qui mettent en avant l’expérience du corps face au spectacle télévisuel. Cet article entend interroger cet impensé, en partant de la thèse selon laquelle nous assistons, avec la démocratisation de la télévision dans les années 1950, à l’émergence de nouvelles représentations du réel en littérature. En vertu du rôle de l’écran qui consiste à d’un côté cacher, de l’autre montrer, chaque expérience technologique est sous-tendue par la présence du corps vécu. En cela, elle est traversée de chair, de spatialité et d’érotisme.
La fin de la télévision ? Téléréalité d’Aurélien Bellanger ou les imaginaires romanesques d’un média « décadent »
Thomas Carrier-Lafleur
L’article explore comment la télé-réalité, vue à travers le roman Téléréalité d’Aurélien Bellanger, reflète les transformations et les perceptions de la télévision comme média. Le texte de Bellanger utilise la télé-réalité pour interroger les liens entre réalité et représentation, et propose une réflexion sur la manière dont ce genre médiatique influence et est influencé par les dynamiques sociales et culturelles contemporaines. Le roman est présenté comme une saga qui trace l’évolution de la télévision, passant d’un média de masse à un phénomène culturel englobant, illustrant sa capacité à modeler et à refléter la société. L’article aborde ainsi les aspects esthétiques et idéologiques de la télé-réalité, mettant en lumière son rôle dans la construction du réel télévisuel et son impact sur l’identité collective et individuelle. Il souligne également le passage de la télévision à des formats numériques et interactifs, marquant une étape de plus dans l’évolution de la narration médiatique. La télé-réalité est analysée non seulement comme un reflet de la société mais aussi comme un agent actif dans la création de nouvelles formes de réalité médiatisée, offrant ainsi une perspective sur la télévision comme un média en constante réinvention.
Être vue, être comme, être avec : la télévision, le soi et autrui
Joyce Cimper
Cet article met en regard le roman d’Alexandra Kleeman, You Too Can Have a Body Like Mine, et divers essais de Martine Delvaux. Ces deux auteures étudient, dans leurs écrits, la télévision et notamment l’impact des images y étant diffusées. Elles exposent entre autres les systèmes qui soutiennent la domination patriarcale et que le petit écran aide à invisibiliser en banalisant les représentations du pouvoir masculin et les violences faites aux femmes. Delvaux et Kleeman réfléchissent à ce que cela signifie de résister aux abus que dépeignent les programmes, de lutter contre les diktats que relayent les publicités dans le but de sérialiser les femmes. Le sujet capital de l’identité et de son contrôle est également abordé par le biais des émissions de télé-réalité et des tendances exhibitionnistes/voyeuristes encouragées par le petit écran. Ultimement, Delvaux et Kleeman proposent un examen de la télévision et de la manière dont elle affecte la société, la perception de soi ainsi que les relations interpersonnelles.
La télé-réalité au prisme de la littérature romanesque : un imaginaire dystopique pour penser les mutations du monde contemporain
Pierre Barrette et Stéfany Boisvert
Cet article explore la représentation de la télé-réalité dans la littérature romanesque contemporaine. À travers l’étude de quatorze romans publiés depuis les années 2000, il est montré que plusieurs thématiques s’y recoupent et nous permettent, si ce n’est de mieux comprendre la télé-réalité elle-même, du moins de mettre en lumière ce que pourrait être un imaginaire littéraire de la télé-réalité. Il est ainsi montré comment ces œuvres décrivent la télé-réalité pour en critiquer les dérives et la représenter comme un phénomène dystopique, incarnant l’aliénation et la manipulation des masses. En plus d’établir plusieurs parallèles entre la télé-réalité et des tragédies historiques, la plupart des romans mettent en lumière ses effets potentiellement destructeurs sur la société, exacerbant ses tendances au voyeurisme, à l’exhibitionnisme, à l’exploitation et au narcissisme. Tout en mettant l’accent sur les dérives morales d’une société fascinée par la télé-réalité, les œuvres tendent toutefois à reconduire une vision critique de la télé-réalité en tant que danger de « féminisation » de la culture. L’article souligne ainsi l’importance de ce genre télévisuel dans la compréhension des mutations médiatiques et sociales de notre époque.